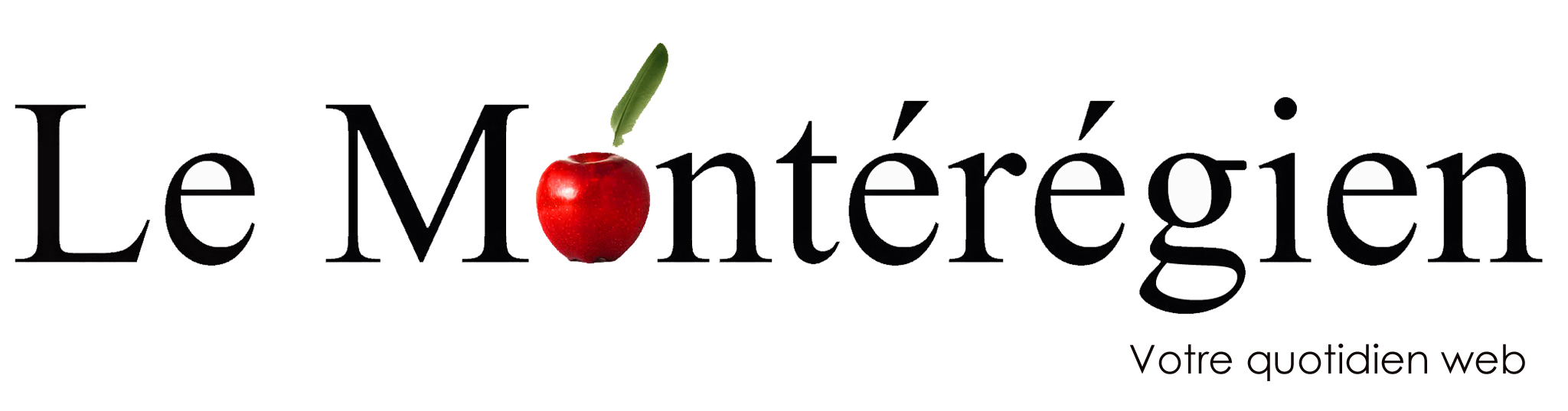Paul-Henri Hudon
Paul-Henri Hudon
HISTOIRE – Des soirées de longs palabres entre habitants voisins, il y en a eu en abondance autrefois. Il arrivait qu’à ces visites impromptues on consommait beaucoup de fumées. On s’échangeait le tabac domestique. Et entre deux bouffées, on placotait de choses et d’autres. On allait même jusqu’à “blaguer” ou se “conter des pipes”. Les volutes de fumée enrobaient les causeries de foyer, comme l’encens de l’église entourait les fidèles de la messe. Elles fondaient la solidarité, instituaient l’universel. Le même enfumage se tenait à la boutique de forge, chez le marchand général, lors de la pause de repos. Le tabac remplissait les temps vides lors d’une attente de service. Bref, le tabac “faisait le plein”.
C’était un usage commun, une forme de convivialité. Un rituel ancien, comme celui d’offrir une rasade de rhum lors d’une transaction d’affaires bien réussie. Parvenus d’Europe, ces rites concrétisaient l’accord, l’harmonie, la bonne entente. Ces pratiques sont disparues dans notre actualité. La cigarette, d’usage individuel, n’a pas remplacé ces “cordials” de circonstance. Ni la signature d’une hypothèque ne se concrétise par la levée d’un verre.
“Le tabac en France, comme en Angleterre, fait partie de la culture populaire, raconte Gilles Havard. Dans les tavernes, on faisait circuler la pipe à la ronde, de bouche à bouche, en <buvant la fumée comme on buvait de l’alcool>. Les voyageurs canadiens participent souvent aux <fumeries> des autochtones, qui sont des lieux de convivialité et de communication avec les esprits“.
“Boire et fumer“, écrit l’historien Gilles Havard, a une telle importance chez les coureurs de bois “que le refus de boire était vécu par les Indiens comme une profonde insulte (p. 583). “Cette consommation relève de la communion pour les hivernants de la pelleterie. Elle constitue une forme de savoir-vivre associée à la virilité” (p. 582). “L’usage est si ancré dans l’univers culturel des voyageurs des Pays d’en haut, qu’ils mesurent les distances par le nombre de pipes fumées entre deux arrêts” (p. 584). Il en était ainsi des soldats lors de longues marches. Un arrêt de repos durait le temps de fumer une pipe.
Références: Gilles Havard, Histoire des coureurs des bois, Perrin, 2021, 1230 pages.
Illustration: La bohémienne, Opinion Publique, 26 novembre 1874.